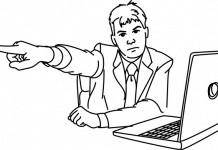Récit d’un hôtelier au temps du Covid | Bruno Mercadal (Brux), Royal Riviera, Carnet de voyage non essentiel
Comme un hommage à Michel Audiard par la truculence de ses propos et son sens de la formule, à l'instar d'un Babycakes Romero qui témoigne de la société, de ses travers par la focale de son Reflex, Bruno Mercadal témoigne régulièrement, sur son "Carnet de voyage" publié sur Facebook, du quotidien du métier d'hôtelier. Mêlant cynisme et bienveillance, il porte un regard aiguisé et sans concession sur l'hôtellerie de son époque, ses acteurs qu'ils soient clients ou hôteliers. Avec toujours en toile de fond, de la bienveillance et la passion pour son Métier d'hôtelier confronté bien souvent à des décisions administratives ubuesques . Pour le pire et souvent le meilleur !
Carnet de voyage non-essentiel.
Cher lecteur, tu connais mon éducation sans faille. Elle trouve ses origines au plus profond du département du 9.3 où j’ai ouvert les yeux. Parfois, il peut malencontreusement m’arriver de dire des gros mots : putain, enc…, mais sache qu’il y a de l’affectueux dans mes dérapages.
J’espère alors que tu pardonneras qu’aujourd’hui je te tutoie, car l’histoire insignifiante que je vais te conter là impose que je le fasse.
Souviens-toi simplement Jacques Prévert, et tu me pardonneras deux fois : « Je dis tu à tous ceux que j’aime même si je ne les ai vus qu’une seule fois, Je dis tu à tous ceux qui s’aiment même si je ne les connais pas ».
Quand j’ai choisi il y a quarante ans de faire ce métier de gueux, j’avais accepté l’idée qu’il n’avait rien d’essentiel. Vendre des piaules et de la bouffe, en soi, il n’y avait rien de très noble dans cette histoire… Du commerce.
Ni médecin pour sauver des vies, ni écrivain pour laisser une trace si forte qu’on m’étudierait à l’école ou qui marquerait, ici et là, des lecteurs touchés par une histoire qu’ils auraient aimé être la leur. C’est beau un livre dans une bibliothèque.
Lorsqu’on me demandait quel était mon métier, je répondais toujours « marchand de bonheur » dans le léger cabotinage qui a toujours été ma marque de (mauvaise) fabrique. Ou taulier, finalement, c’est pareil.
Et puis chemin faisant, j’ai rencontré des gens, des gens riches et des moins riches, mais toujours des gens qui me confiaient un pan de leur vie, un moment de bonheur en suspens. Des gens avec un cœur, une âme. Des cœurs, des âmes, en demande. Un dîner, une demande en mariage, le repas de baptême de ce qui leur tient le plus à cœur : leur enfant. Et puis aussi des nuits d’amour entre deux êtres aux cœurs chavirés. Des nuits de passion. C’est beau la passion, ça mérite qu’on s’en occupe bien, qu’on la nourrisse, qu’on la file en pâture aux étoiles filantes pour la faire briller encore plus haut. Des fois aussi, j’ai du balancer des seaux d’eau, comme pour les chats. C’est ça mon métier.
Tu foires la réservation d’une chambre où va se dérouler la première niquade* d’un couple à l’orée d’une histoire magnifique qui va conditionner leur futur ? Tu te rends compte de la responsabilité ?
Qu’importe le flacon dit l’adage. Mais il est des cas où le flacon participe à l’ivresse, il la transcende, il la rend non simplement plus belle, mais plus important encore, il la rend simplement possible. Oui, c’est ça : possible.
Souvent, j’ai eu l’impression, furtive, de participer à la pose de la première pierre du chemin des possibles de beaucoup d’histoires. Pas une fierté, non, une satisfaction, une joie parfois. La sensation de la tâche accomplie. La sensation de la goutte qui ne fait pas déborder le vase, mais qui fait déborder le bonheur, qui éclaire d’extraordinaire un moment de vie ordinaire.
Enfin, je prenais mon métier au sérieux.
Un jour, un client anglais m’a demandé s’il pouvait planter un arbre dans le jardin, derrière l’orangerie, à l’endroit même où il avait demandé la main de sa femme un an plus tôt. J’ai dit oui. Deux ans plus tard, l’arbre était mort.
C’est Beigbeder qui avait raison : l’amour dure 3 ans. Pourtant, on avait fait le taf. Mais bon c’est une anecdote qui ne reflète pas, tu le sais bien, la réalité des couples.
Et puis il y a eu le Covid et cette classification, essentiel, non-essentiel. Le non-essentiel au rebut. Classé, asphyxié, réduit au silence et à

l’anxiété
Cloué au pilori de la non-essentialité. Contaminant, minant tout court. Il y a là quelque chose qui peut rendre malheureux, au-delà du besoin de travailler pour vivre, et qui piétine sans vergogne ce dont la plupart des humains ont besoin pour vivre dans l’harmonie : la reconnaissance.
Cher lecteur, ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit (Brux adore anticiper les polémiques propres au monde du Web, quand l’internaute est planté devant son écran, et passé au gonfleur Michelin d’une ou plusieurs 1664), j’ai bien compris que des gens souffraient, mourraient, que les soignants étaient désemparés, et que ce n’était pas une bonne idée que d’inviter des gens dans des restaurants ou dans des lieux bondés qui ne feraient qu’empirer les choses.
C’est la sémantique qui me gêne. Une sémantique de technocrates, rompus aux classements abrupts, à l’expéditif, à la distribution de leçons moralistes, qui s’exonèrent d’une bienveillance qui aurait été de circonstance sans se soucier du cœur des hommes, et sans jamais renoncer à leur salaire. L’histoire politique se répète, inlassablement.
Tout à l’heure dans la voiture, la playlist YouTube me balance « la quête » de Brel, et j’ai pensé à tous ces auteurs, ces chanteurs, aux artistes en général. A la vie sans musique, sans chanson, sans l’art qui éclaire des vies, qui éclaire la vie tout au long du chemin. Longtemps souvent, intensément toujours.
Et encore plus en ce moment où la musique est la meilleure compagne des détresses en devenir. Où la musique remplit et rythme de manière essentielle les millions de foyers qui se laisseraient mourir du silence imposé par un confinement qui n’en finit plus de finir.
« Telle est ma quête
Suivre l’étoile
Peu m’importent mes chances
Peu m’importe le temps
Ou ma désespérance
Et puis lutter toujours
Sans questions ni repos
Se damner
Pour l’or d’un mot d’amour »
Classés non-essentiel les artistes, comme les restaurateurs, et d’autres professions qui ont donné leur vie, parfois celle de leur famille, à leur passion. Mais bordel de merde, « la quête », Brel, d’autres, plein d’autres, non-essentiels ?
Alors, enivre-toi, comme l’écrivait Baudelaire, « de vin, de poésie, ou de vertu », et si tu peux le faire, si tu peux même simplement rêver de le refaire un jour, bientôt peut-être, c’est parce qu’une armée de gugusses devenus non-essentiels est là, en résistance, au garde à vous, et fiers de faire que la vie sans eux n’aurait jamais été la vie.
« Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve.
Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous.
Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l’ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est ; et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous répondront : « Il est l’heure de s’enivrer ! Pour n’être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse ! De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. »
Bruno Mercadal (alias Brux)
*(mot d’argot synonyme de la bête à deux dos chère à Rabelais, Gargantua chapitre 3)